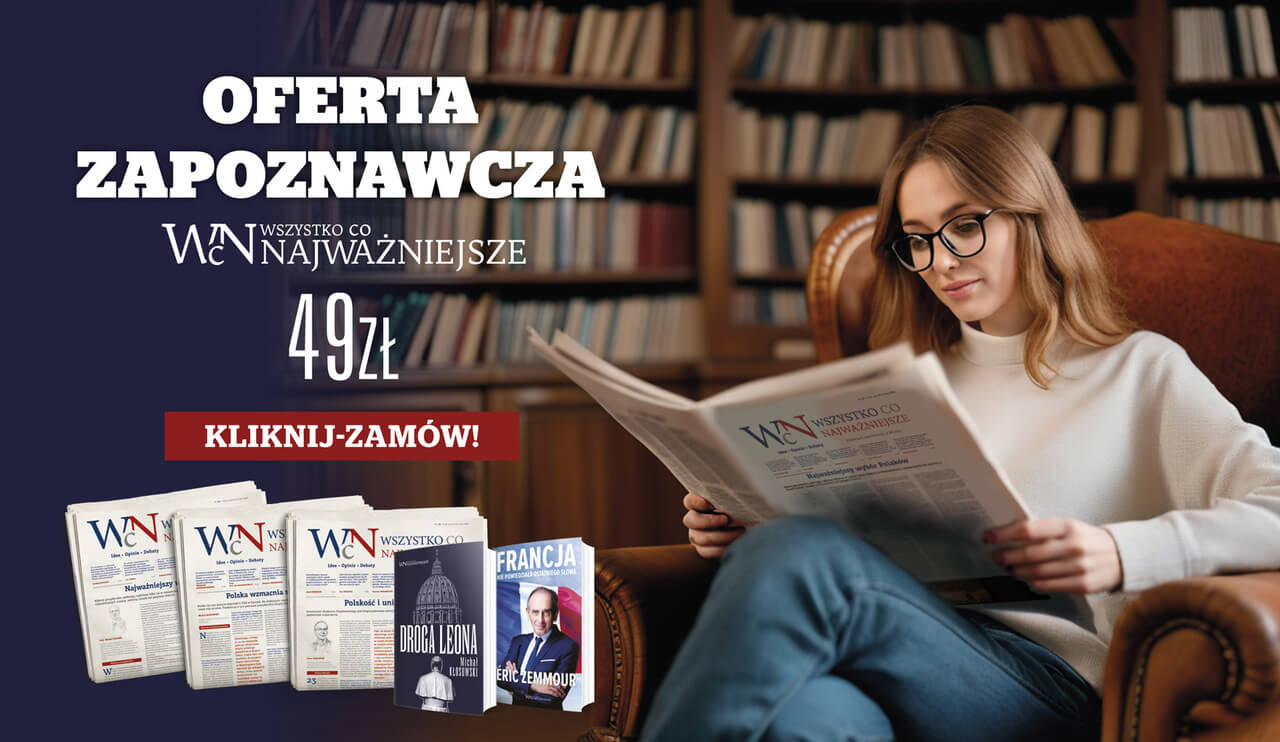Wrocław – ville reconstruite, ville à reconstruire
Wrocław – ville reconstruite, ville à reconstruire
Je n’oublierai jamais l’impression que j’ai ressentie en voyant Wrocław pour la première fois. C’était comme s’il y avait à la fois trop et trop peu de quelque chose; comme s’il y manquait quelque chose. Car cette ville est comme une phrase interrompue en plein milieu, et ensuite, des années plus tard, comme si quelqu’un avait tenté de la finir dans une autre langue – note Michał KŁOSOWSKI
.Une ville rebâtie sur ses ruines, mais toujours mal comprise. Voilà le Wrocław que je connais et que je raconte à mes amis. Et bien que resuscitée de ses cendres, la ville demeure un lieu où non seulement on vit, mais où l’on cherche aussi sans cesse un sens à sa vie : c’est le cas des étudiants originaires des quatre coins du pays, des migrants venus d’Ukraine et des Polonais arrivés ici après la guerre.
Wrocław était alors un laboratoire pour un monde nouveau. Une ville de déplacés, d’exilés, de gens qui avaient perdu leur foyer et qui devaient réinventer la notion de « chez-soi ». Ils y ont apporté leurs souvenirs de Lviv, Vilnius et Grodno, et tentaient de les parquer entre l’Oder et la rue Świdnicka, entre la place du marché détruite et les immeubles délabrés, entre les quartiers résidentiels et les champs de la périphérie. Chaque brique portait en elle l’empreinte des absents, comme une rappel de leur départ – et l’éventualité de leur retour…
La littérature était alors la seule forme de dialogue qui subsistait. Ce sont les écrivains qui, les premiers, ont entendu la voix de la ville, avant même que son vacarme ne s’éveille. Tadeusz Różewicz a écouté le silence des ruines et l’a consigné dans ses poèmes, comme si les décombres étaient la preuve que chaque mot devait être purifié, reconstruit et ancré dans la vérité. Mais c’est Marek Hłasko qui a insufflé à cette ville la rébellion, la saleté et la colère. Le Wrocław de Hłasko n’est pas un panorama de ponts, mais un arrière-pays de bars laitiers, de gares et de cours intérieures, où la vie exhale des odeurs d’essence, de labeur, de désillusion et de lutte. Hłasko, à peine adolescent après la guerre, voyait Wrocław moins comme une ville d’avenir que comme une ville d’innocence perdue. C’est là qu’est né son mythe : celui d’un jeune écrivain rebelle qui, dans les ruines d’un monde nouveau, ne voyait que ses mensonges, cherchant intuitivement à regarder derrière les coulisses, à distinguer le vrai du faux. Pour lui, Wrocław n’était pas sa maison, mais son champ de bataille : pour la vérité, pour le sens, pour la dignité, pour l’avenir et ce qui allait suivre. Là où d’autres voulaient reconstruire, il voulait déconstruire : jusqu’au cœur même de la réalité, aussi crue fût-elle. Car pour reconstruire véritablement, il faut d’abord savoir ce qui s’est effondré.
Le Wrocław de Hłasko et celui de Różewicz sont les deux pôles d’une même expérience. D’un côté, le silence après la catastrophe ; de l’autre, le cri contre la nouvelle falsification qui ressortait des ruines de celle d’avant. C’est précisément entre ces deux tons que se déploie le récit local du XXe siècle : celui d’un peuple qui a cessé de croire aux grands discours, mais qui croit encore à la nécessité de parler. Quand le grand discours est perdu, quand le grand discours est perdu. Et puis d’autres sont venus après eux : Olga Tokarczuk, dont la Basse-Silésie est devenue un mythe de mémoire, de ce qui est local, de voyage et de transformation ; Marek Krajewski, qui des ténèbres du Breslau d’avant-guerre a extrait le crime et la mélancolie ; Karol Maliszewski, qui sait extraire la métaphysique des événements du quotidien, comme si elle était une réalité accessible à tous lors d’une promenade dans les rues pavées. Tous, à leur manière, ont ajouté de nouvelles lignes à cette histoire sans fin d’une ville qui doit constamment se justifier – même à elle-même.
Car bien que reconstruite, c’est une ville à reconstruire sans cesse : spirituellement, symboliquement, linguistiquement et sémantiquement. Chaque génération en réinterprète le sens, à l’instar des premiers habitants qui posaient des briques sur un site qui n’était pas encore le leur. Car Wrocław n’a jamais été « achevée ». Elle ressemble davantage à un palimpseste, écrit, effacé, puis réécrit. Et ainsi de suite.
Car quand on déambule dans ses rues, on a l’impression que cette ville ne cesse de poser des questions. Sur la mémoire, l’identité, la communauté, et finalement, sur l’être humain qui, en flânant, foule les pavés comme pour y laisser une trace de son passage dans ce récit séculaire. Elle interroge aussi la manière de vivre dans un lieu qui a connu tant de renaissances : après la destruction, la division, la perte et la renaissance de l’espoir, les hauts et les bas, la lutte contre les éléments. Car cette ville, bâtie sur des ruines et des rêves, est devenue bien plus qu’un simple lieu de vie : elle est une sorte de laboratoire de la paix, où l’histoire et le présent tentent de dialoguer, reconnaissant l’effort humain et la volonté d’agir comme un espace de dialogue. Ici, entre mémoire et avenir, l’homme redécouvre le sens de la coexistence : avec les autres, avec lui-même, avec ce que le temps lui réserve ; les poètes l’ont chanté. Wrocław n’est donc pas seulement une ville de littérature, mais aussi une métaphore de l’Europe. Un continent qui tente encore de se reconstruire sur ses propres ruines, non pas avec des briques, mais avec des valeurs. La ville sur l’Oder nous enseigne que la véritable reconstruction ne consiste pas à recréer le passé, mais à savoir l’embrasser. On ne peut vivre dans les ruines, mais on peut vivre avec leur mémoire, leur donner un sens et bâtir du nouveau sur elles.
.Wrocław est aussi une ville qui ne finit pas. Une ville où l’on parle tantôt polonais, tantôt allemand, tantôt tchèque, et tantôt simplement le silence de l’Oder. Une ville qui a survécu ayant appris à pardonner, et grâce à cela, elle continue de reconstruire l’homme.