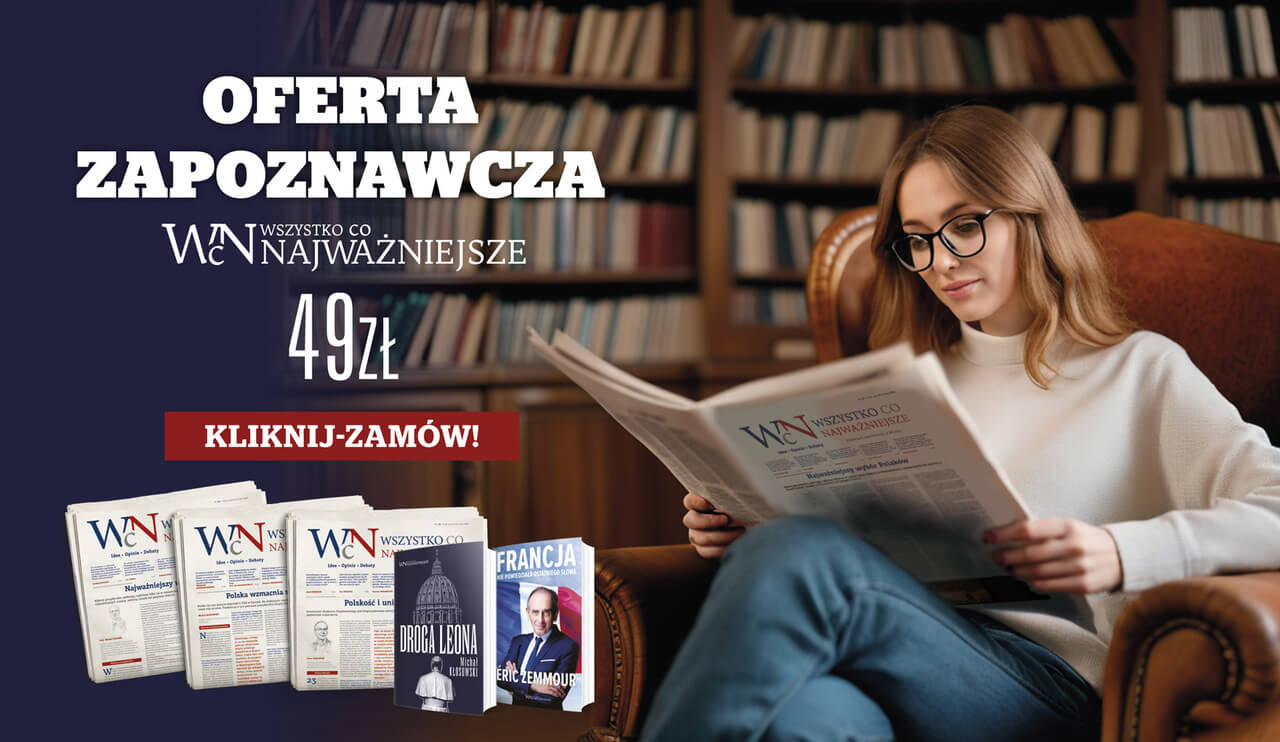Une leçon importante de 1965
Une leçon importante de 1965
Dans la lettre des évêques polonais aux évêques allemands de 1965 se trouve une méthode originale de résolution des conflits, de gestion du traumatisme des conflits sanglants entre nations, qui peut également être une leçon précieuse pour nous aujourd’hui dans nos relations avec les Ukrainiens – affirme Andrzej JERIE.
Anna DRUŚ : Le Centre d’histoire Zajezdnia propose une exposition, présentée au Sénat de la République de Pologne, intitulée « Réconciliation pour l’Europe ». Pouvez-vous nous dire en quoi elle consiste ? Est-ce la première fois qu’elle est présentée et comment a-t-elle atterri au Sénat ?
Andrzej JERIE : Il s’agit de la deuxième étape de son voyage à travers l’Europe. La première s’est achevée il y a quelques semaines à Rome. Le caractère unique de l’exposition au Sénat vient du fait que nous présentons ici pour la première fois au public trois documents qui font également l’objet d’une demande d’inscription auprès de l’UNESCO sur la Liste du patrimoine mondial « Mémoire du monde ».
Je pense d’abord au manuscrit de la lettre des évêques polonais aux évêques allemands, rédigé en personne par l’archevêque Bolesław Kominek. À partir de ce manuscrit a été établie, et puis signée par trente-six Pères conciliaires polonais lors de la dernière session du Concile du Vatican en 1965, le document officiel. Et puis, je pense à la réponse des évêques allemands, également rédigée à Rome et remise aux évêques polonais en décembre 1965. L’exposition elle-même relate le contexte historique de ces documents, leur message et leur impact.
Je suis convaincu que les mots « Nous pardonnons et demandons pardon », prononcés seulement 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, constituent un message absolument extraordinaire. Ils arrivent à un moment où les blessures de cette grande tragédie n’étaient pas encore cicatrisées, où, dans chaque foyer polonais, on pleurait une victime de la guerre ; et si l’on pense aux Polonais d’origine juive, ceux qui ont survécu à la guerre étaient le plus souvent des personnes sans famille, des survivants solitaires. Dans ces conditions, sur les ruines de cette immense tragédie, un message tout à fait extraordinaire et unique se construit, né d’un esprit chrétien puissant, de la capacité de pardonner les péchés et de demander pardon, mais aussi d’une réflexion qui puise sa source dans l’expérience de l’archevêque Kominek.
Ce Silésien de la région frontalière parlait couramment l’allemand et connaissait par sa propre expérience la complexité de la coexistence de deux nations. C’est aussi le fruit d’une réflexion profonde et intense. Les mots contenus dans la lettre, ce message « nous pardonnons et demandons pardon », étaient son idée personnelle, issue de sa pensée originale. Il avait déjà écrit de manière similaire et entrepris des actions similaires, mais jamais dans un contexte aussi large. Grâce à ce message, elles ont une portée à long terme.
– Où en serait-on aujourd’hui si cette lettre n’avait pas été rédigée, si cet acte n’avait pas eu lieu ?
– En 1965, un profond ressentiment régnait en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs millions d’Allemands, sommés de quitter leurs maisons, ont dû s’adapter à un nouveau contexte. Ils n’étaient pas du tout les bienvenus dans les nouveaux territoires. C’est pourquoi l’acceptation par la nation allemande de la nouvelle frontière germano-polonaise sur l’Oder et la Neisse était inférieure à 30 %. Et c’est après cette lettre que la situation a changé en quelques années seulement. Cependant, ce n’était pas seulement une question de temps, mais aussi de nombreuses actions nées en Allemagne, notamment dans l’Église évangélique, mais aussi dans l’Église catholique, qui ont précédé la lettre et qui constituaient une réponse concrète des Allemands à cette main tendue vers la réconciliation.
Bien que la réponse des évêques allemands à la lettre n’ait pas été très satisfaisante – elle a été plutôt froide – ce geste polonais a marqué les élites allemandes. C’est là que, dans la première moitié des années 1960, des initiatives de pèlerinages pénitentiels en Pologne, à Auschwitz et ailleurs ont vu le jour. Plus tard, dans ces milieux, une initiative a vu le jour pour promouvoir l’élévation du père Maximilien Kolbe à la gloire des autels.
Il s’agit d’une initiative conjointe, polono-allemande. Kolbe devient le parrain de la réconciliation et de la réparation des dommages causés par les Allemands par la Seconde Guerre mondiale, dont Maximilian-Kolbe-Werk est un symbole. Certes, on peut parler d’un signe isolé, mais il s’agit du symbole d’une véritable transformation des relations polono-allemandes. Elle s’est traduite par le fait que le révisionnisme concernant la frontière, si répandu chez les Allemands au début, est devenu un phénomène marginal. Cette transformation s’est également manifestée par l’émergence de nombreuses initiatives et coopérations conjointes polono-allemandes. Exemple, la Fondation Krzyżowa pour la compréhension européenne, créée il y a 30 ans, qui mène un dialogue permanent polono-allemand et éduque les jeunes Polonais et Allemands à la coexistence et au dialogue. Ce sont des processus à long terme qui se poursuivent depuis des décennies et qui portent leurs fruits. Ce sont des générations de Polonais et d’Allemands qui ont été nourries du message des évêques. S’il est facile aujourd’hui de raviver l’hostilité et la méfiance, je pense que ce message est plus fort.
– Que nous apprend cet événement de 1965 dans le contexte des relations polono-ukrainiennes telles qu’elles sont aujourd’hui ?
– Dans la lettre des évêques polonais aux évêques allemands, on trouve non seulement cette phrase monument, citée ci-dessus, mais aussi une méthode de résolution des conflits, de traitement du traumatisme des conflits sanglants entre nations. Cette méthode consiste avant tout à dire la vérité. La lettre des évêques est une sorte de leçon sur les relations germano-polonaises. Elles sont abordées sans éluder les sujets délicats, les crimes sont nommés par leurs noms, le nombre de victimes est indiqué, mais cette leçon inclut également des aspects positifs.
Et c’est la première étape de la réconciliation. On peut voir que notre histoire n’a pas toujours été mauvaise, que nous n’avons pas à notre actif que des crimes, des tragédies, des injustices et des victimes, mais qu’il y a aussi des éléments sur lesquels nous pouvons bâtir. Puis, la lettre comprend également la reconnaissance de la bonne volonté de l’autre partie, on ne la considère pas comme un éternel ennemi. Il y a aussi l’ouverture au dialogue, ce qui implique un désir de comprendre l’autre partie. Et enfin, la lettre tend la main, c’est-à-dire sort du cercle vicieux de la relation victime-agresseur, du rôle de victime. Se relever, se mettre debout, voir que nous pouvons être partenaires. Mais aussi admettre sa culpabilité. Admettre que je ne suis pas seulement une victime, mais que je peux aussi avoir une part de culpabilité. C’est une façon purement chrétienne de penser.
Ces trois étapes sont également essentielles pour l’amélioration des relations polono-ukrainiennes, dont le sujet le plus brûlant est bien sûr le génocide de Volhynie. Les Ukrainiens ne comprennent pas pourquoi les Polonais ne sont pas satisfaits de leur approche du sujet. Ils se demandent combien de fois il faut s’en excuser, alors que de tels gestes officiels ont été répétés à maintes reprises au niveau des chefs de l’État. Cependant, il y a certainement une leçon de vérité à tirer de leur côté, à savoir la poursuite de l’exhumation des victimes et puis la question du culte des auteurs de ces meurtres, toujours vif en Ukraine.
Tout cela exige la vérité. Pour guérir ces blessures, il nous faut aussi porter un regard critique sur notre histoire et ne pas nous considérer uniquement comme des victimes. Sortir du rôle dans lequel nous risquons d’être enfermés dans ces relations. À Wrocław, nous percevons ce problème et le traitons davantage comme un défi, comme une tâche. Et nous sommes profondément convaincus que cette question historique n’est pas sans importance. Qu’il ne s’agit pas seulement de simple bon voisinage aujourd’hui, mais aussi de régler nos comptes avec les événements historiques. Car bien souvent, le passé est instrumentalisée pour créer des clichés, des cadres d’interprétation dans lesquels nous plaçons des personnes avec qui nous vivons au quotidien, travaillons, qui sont nos voisins, nos partenaires commerciaux. Et les considérer comme des partisans de Bandera ne servira à rien. Nous devons sortir de cette logique, aider tant les jeunes que les personnes plus âgés, car de nombreux groupes générationnels sont confrontés à ce problème. Mais je crois qu’une prise de position aussi courageuse peut changer les choses.
– Pensez-vous qu’il serait attendu que l’Église polonaise fasse un geste similaire à celui de 1965, c’est-à-dire qu’elle rédige une lettre au clergé ukrainien, d’autant plus qu’une grande partie de ces ecclésiastiques sont des catholiques grecs, donc membres de la même communauté que les catholiques ?
– Un tel geste a déjà été fait, et il a repris les mots exacts de la lettre de 1965. Je parle de la lettre des évêques gréco-catholiques d’Ukraine et des évêques catholiques romains de Pologne intitulée « La paix entre les nations est possible », rendue publique en 2005. Elle n’a pas eu un écho ni un impact comparable à la lettre aux évêques allemand. Un geste encore plus fort est peut-être nécessaire. Je pense que la référence à la communauté de l’Église catholique et aux valeurs chrétiennes communes pourrait être essentielle. Le problème vient peut-être du fait que le rôle de l’Église gréco-catholique en Ukraine n’est pas aussi important que celui de l’Église catholique en Allemagne et en Pologne dans les années 1960. En Pologne, il a été possible de préparer le millénaire du baptême : sur les remparts de Jasna Góra, des centaines de milliers de fidèles ont suivi le primat Wyszyński, un peu contre leur gré, peut-être contre ce que leur dictait leurs cœurs, en criant : « Nous pardonnons, nous pardonnons !» Peut-être aurions-nous besoin aujourd’hui de telles autorités qui, malgré le simple instinct du cœur et des émotions, proposeraient quelque chose capable de changer l’histoire.
Propos recueillis par Anna Druś