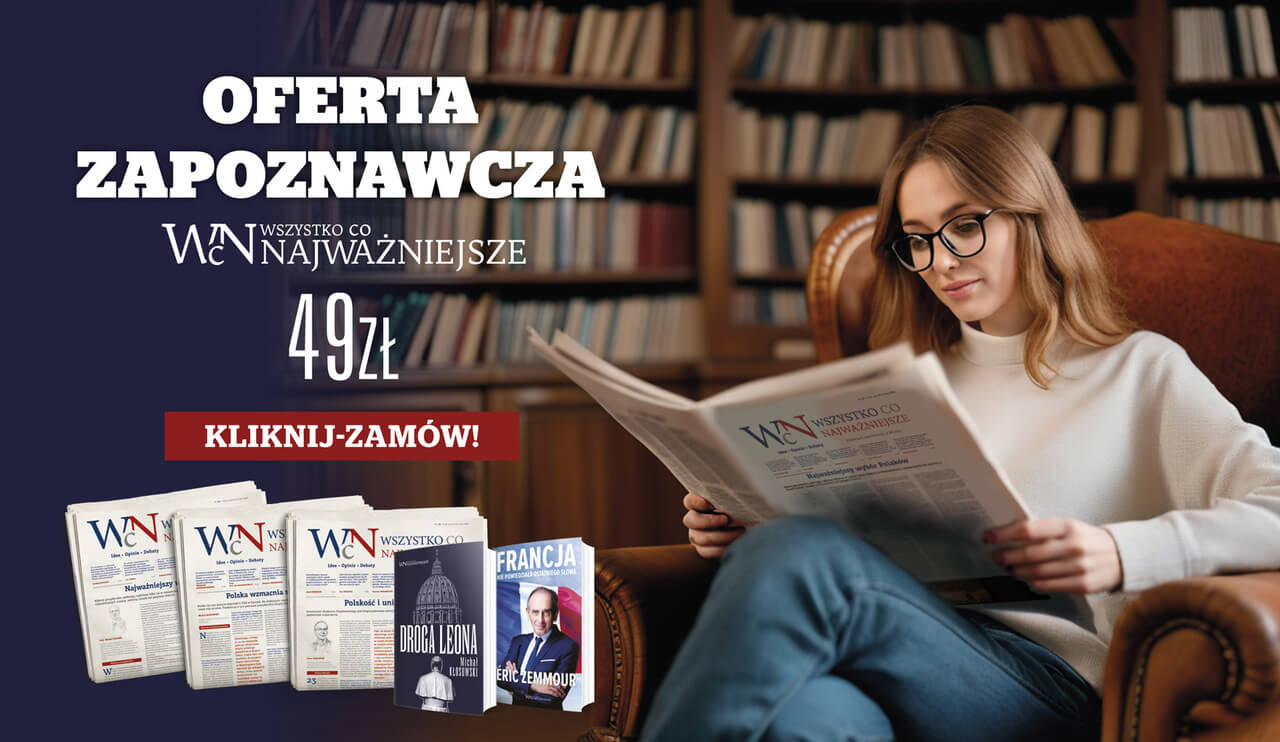La fête de la liberté polonaise
La fête de la liberté polonaise
Aux XIXe et XXe siècles, la Pologne fut véritablement indépendante pendant un peu plus de trois décennies. La liberté dont nous jouissons aujourd’hui nous impose un devoir encore plus grand.
«Nous sommes libres !», annonçait joyeusement le journal Kurier Warszawski. C’était le 12 novembre 1918. La veille, dans la lointaine ville de Compiègne, les Français et les Britanniques signèrent avec une délégation allemande un armistice mettant fin aux combats sanglants de la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, des dizaines de milliers de soldats et de fonctionnaires armés allemands se trouvaient encore à Varsovie. Cependant, ils n’avaient plus envie de se battre, à tel point qu’ils rendirent sans difficulté leurs armes, même à des étudiants et des lycéens. « Effrayés par la révolution qui éclata avec véhémence à Berlin et dans toute l’Allemagne, et surtout surpris par l’abdication du Kaiser et des princes allemands, ils perdirent la tête », nota l’archevêque Aleksander Kakowski, témoin de ces événements. « Dans ces circonstances, le désarmement des Allemands se passa sans heurt. L’exemple varsovien fut suivi par le pays tout entier. »
À Lublin, ville occupée jusque-là par les Autrichiens, Jadwiga Orłowska, âgée de vingt ans, observa des scènes similaires : « Tous les entrepôts militaires aux mains des Polonais. Les des voitures sont conduites par des Polonais. […] des enfants, des garçons de 10 à 15 ans, ont occupé les bâtiments gouvernementaux et les entrepôts. Les chemins de fer et la poste sont dès aujourd’hui sous notre contrôle. […] Notre armée, l’armée polonaise, défile à nouveau dans les rues. » Pour Orłowska, c’était un temps de joie : « Pour la première fois, j’ai ressenti ce que signifie travailler pour moi-même… »
En ces jours de novembre, quiconque voyait plus loin que le bout de son nez, était entièrement absorbé par la politique. « La science est désormais reléguée au dernier plan, et serait moqué celui qui voudrait s’y réfugier comme dans un oreiller », réagissait sur le coup l’éminent historien cracovien, Władysław Konopczyński. L’inquiétude et la peur étaient palpables, mais l’enthousiasme, lui, était bien présent. « Enfin, nous sommes maîtres dans notre pays », soulignait le Kurier Warszawski, déjà cité. « Enfin, après plus de cent vingt ans, l’heure est venue où il n’y a plus d’invasion étrangère ici. »
Une longue marche vers la liberté
Plusieurs générations de Polonais avaient attendu avec espoir ce moment – n’ayant jamais succombé à l’idée qu’à la fin du XVIIIe siècle, leur pays avait disparu des cartes de l’Europe, incapable de résister à trois empires conquérants : la Russie, la Prusse et l’Autriche. À l’automne 1918, la situation géopolitique était enfin favorable : la Russie était plongée dans la guerre civile, l’Allemagne au bord de la révolution et l’Autriche-Hongrie s’effondrait. Cependant, une liberté durable n’aurait jamais été possible sans les germes de l’armée polonaise formée pendant la Première Guerre mondiale, un lobbying diplomatique efficace à Paris et à Washington, et, auparavant, les efforts constants de l’Église catholique, de nombreux artistes et d’une multitude de militants sociaux pour que l’esprit patriotique ne s’éteigne pas, malgré les tentatives de russification et de germanisation.
En novembre 1918, les frontières polonaises étaient loin d’être assurées, tout comme la pérennité de son indépendance. Nous devions combattre les Allemands pour nos frontières occidentales lors de quatre soulèvements armés : le soulèvement de Grande-Pologne et trois soulèvements silésiens. La plus grande menace, cependant, venait de l’est, de l’Armée rouge, qui, sous ses baïonnettes, semait la mort, les destructions et la régression civilisationnelle. Contrairement à leurs propres slogans sur le droit des nations à l’autodétermination, les bolcheviks, au début des années 1920, anéantirent les États indépendants des Azéris, Géorgiens, Arméniens et Ukrainiens. Ils cherchaient à infliger le même sort aux Polonais.
Le rôle clé, y compris pour le sort de l’Europe, eut la bataille de Varsovie, quand, en août 1920, l’armée polonaise stoppa définitivement l’avancée de la sanglante Révolution rouge pour près de vingt ans. La victoire sur la Russie de ce jeune État, à peine sorti d’une triple domination et dont le territoire avait été durement touché par la Grande Guerre, reste encore aujourd’hui méconnue à l’étranger. Ce triomphe n’aurait pas été possible sans la mobilisation sociale massive et la clairvoyance de toutes les grandes forces politiques qui, malgré leurs profondes divergences, surent œuvrer main dans la main dans le danger.
En 1939, la défense héroïque ne suffisait plus lorsque la Pologne fut victime d’une double agression : d’abord par l’Allemagne nazie, puis, 17 jours plus tard, par l’Union soviétique. Une période de terreur s’ensuivit, qui, pour mes compatriotes, ne prit pas fin avec la chute du Reich nazi. Après la guerre, la Pologne renaquit théoriquement en tant qu’État indépendant, mais elle demeura pour des décennies dans la sphère d’influence de Moscou. Les communistes réprimèrent brutalement toute tentative de résistance, jusqu’à la révolution pacifique de Solidarnosc dans les années 1980 qui nous apporta enfin une liberté retrouvée.
L’indépendance est un devoir
Je suis issu d’une génération qui a grandi à la charnière de deux époques : le communisme agonisant et la démocratie parlementaire. Je sais combien nous devons aux générations précédentes. Historien et militant, j’ai toujours accordé une grande importance à ce que les héros de notre liberté soit honorés dignement : les membres de Solidarnosc, les soldats de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance indépendantiste d’après-guerre, ainsi que tous ceux qui, il y a plus d’un siècle, combattirent pour l’indépendance de la Pologne et qui la défendirent par la suite.
Célébrée le 11 novembre, la Fête de l’Indépendance, instituée pour commémorer les événements de 1918, est l’une des journées les plus importantes du calendrier polonais. La Marche de l’Indépendance, organisée à Varsovie et rassemblant de nombreux groupes patriotiques manifestant leur attachement au drapeau national blanc et rouge, est devenue une belle tradition. Ces dernières années, en tant que président de l’Institut de la mémoire nationale, j’ai également participé aux cérémonies officielles du 11 novembre, en présence des plus hautes autorités de l’État et du corps diplomatique. Cette année, je participerai aux célébrations pour la première fois en tant que président de la République de Pologne.
L’indépendance est une immense responsabilité, et cela est sans doute plus évident aujourd’hui qu’il y a quelques années. La guerre, suite à l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, menace à nouveau nos frontières. Nous avons besoin d’une armée encore plus forte et d’un consensus sur les questions fondamentales de sécurité, tant en Pologne qu’au sein de l’OTAN. Bien que pleinement intégrés à l’Europe, nous devons aussi veiller à rester fidèles à nous-mêmes et ainsi préserver notre identité et notre souveraineté polonaises. Un pays de près de quarante millions d’habitants ne peut se réduire à une simple base de production pour de plus grandes économies. Nous devons avoir de l’ambition et être capables de grandes choses.
Pour nous-mêmes et pour les générations futures. Pour la Pologne.