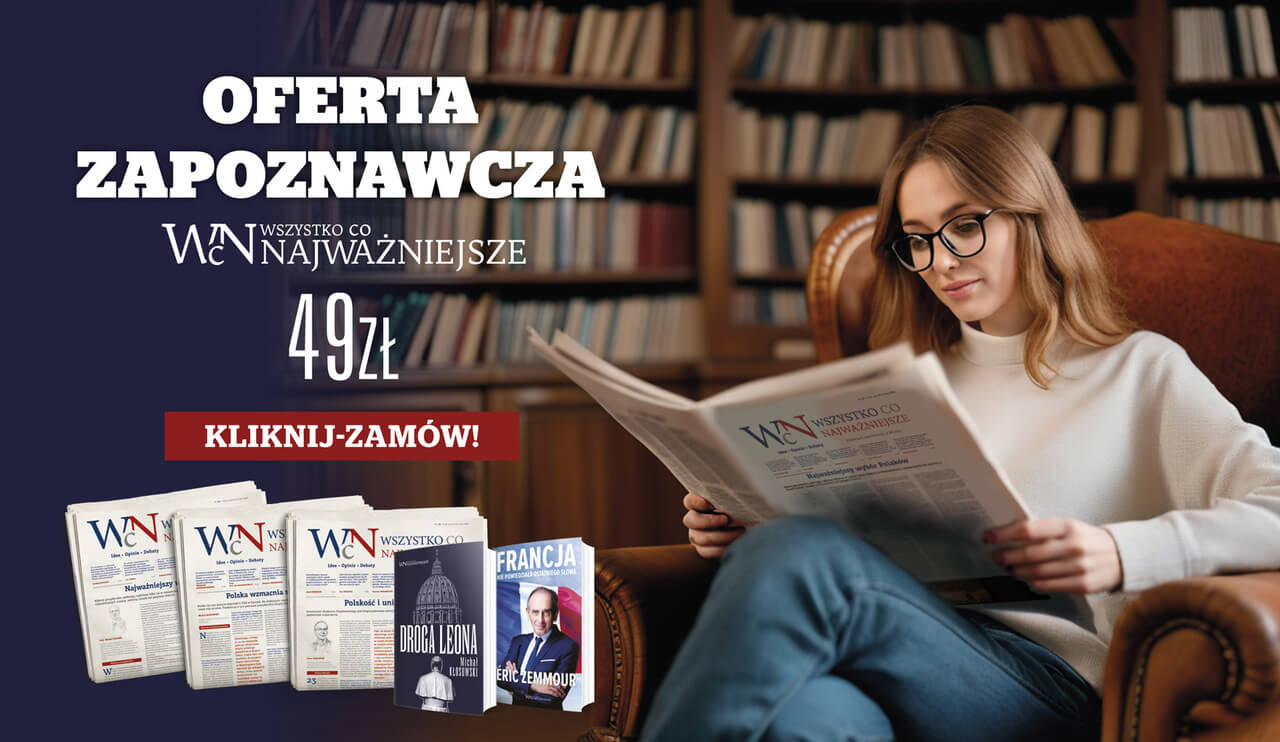La Ballade
La Ballade
La Ballade en fa mineur, considérée comme le sommet du genre par ses références à la tradition, sa force créatrice de nouvelles orientations pour les générations suivantes de compositeurs, à travers l’objectivité des procédés alliée à une expression extrêmement personnelle, est la quintessence du syncrétisme, un symbole singulier de la perception romantique du monde, et en même temps un message intemporel, compréhensible et interprété de manière créative jusqu’à nos jours.
.«un conte fondé sur la trame des événements de la vie courante ou de l’histoire des chevaliers, le plus souvent animé par l’étrangeté du monde romantique, chanté sur un ton mélancolique, sérieux dans le style, simple et naturel dans les expressions»[1]. Il serait difficile de trouver une caractérisation de la ballade plus juste et concise que ces paroles d’Adam Mickiewicz, consignées dans la préface de Ballades et romances – un recueil de poésie dont la publication en 1822 est considérée comme la naissance symbolique du romantisme polonais.
Ce n’est pas par hasard que Mickiewicz a choisi le genre de la ballade dans sa nouvelle forme romantique. Il s’inscrivait ainsi dans la tendance initiée par des maîtres de la plume tels que Bürger, Schiller et Goethe. Mais la nouvelle ballade le séduisait aussi par ce qui fascinait le plus la jeune génération de poètes : une aura de mystère, l’interpénétration des mondes réel et féerique, son lien avec la culture populaire, des personnages expressifs, une intrigue simplifiée, des conflits principaux dramatiques, et enfin un syncrétisme particulier de l’épopée, du lyrique, du drame, d’images fortes… et de la musique. L’héritage des modèles du genre, provenant du XIIIe siècle, enrichissait encore sa signification culturelle d’associations d’idées avec des vestiges de concepts et d’opinions à caractère de topoï recouverts par le temps d’une épaisse couche de mousse, mais aussi avec la morale et la vision du monde de la culture populaire.
Frédéric Chopin a grandi à Varsovie dans l’ambiance de ce romantisme, entouré non seulement de bons compositeurs (Elsner en tête), de très actifs éditeurs de musique et facteurs de pianos, de compositeurs d’opéra, florissant à l’époque, mais aussi de poètes de la nouvelle vague, tels que Witwicki et Odyniec. Déjà enfant, il avait une prédilection connue pour l’improvisation de scènes épiques au piano. Surtout dans un cercle intime, entre amis, il organisait des séances pour ses collègues – des nobles, élèves en pension chez son père – au cours desquelles la narration musicale et les compétences pianistiques croissantes de Chopin se mêlaient à un sens de l’humour espiègle et à la vitalité énergique de la jeunesse.
Cet élément épique deviendra si important dans l’œuvre de Chopin, que lorsqu’il s’écartera des modèles classiques et brillants de ses premières compositions de Varsovie (en particulier celles avec orchestre), il se tournera vers le genre de la ballade, devenant le premier à en créer une version entièrement dépourvue de paroles. Les ballades étaient probablement aussi – mis à part leur enracinement dans le contexte culturel entourant le jeune Chopin – une réponse aux compatriotes qui le pressaient d’écrire des opéras patriotiques, après la défaite de l’insurrection de Novembre et la catastrophe pour la souveraineté polonaise. Lorsqu’il arriva à Paris en 1831, après les mois de nocturne et solitaire « piano fulminant »[2] passés à Vienne, Chopin était déjà suffisamment mûr et conscient de son goût pour savoir parfaitement faire la distinction entre d’une part sa fascination pour l’opéra et les voix des chanteuses, son inclination à créer des formes narratives remplies d’émotion, sa capacité à mettre des histoires en sons, et d’autre part ses préférences professionnelles concernant la composition. Il savait qu’en utilisant le langage universel de la musique, il transmettrait plus de choses, de manière plus profonde et plus large.
Il est fort probable qu’à cette époque, il avait déjà dans ses esquisses les grandes lignes de sa première ballade et du premier scherzo – un autre genre romantique qu’il a véritablement recréé – poussant le concept beethovenien de « plaisanterie musicale » dramatisée (scherzo signifie littéralement « plaisanterie ») à un extrême de contrastes presque diabolique. Il savait que sa force résidait dans sa façon d’explorer le piano comme une sorte de cosmos musical, ce qui lui donnait déjà à cette époque la possibilité d’imiter non seulement le lyrisme et le drame de la voix, mais aussi de l’orchestre tout entier. Il savait que sa sensibilité et sa façon d’entendre le destinaient à la synthèse et à la sublimation, à une économie d’expression spécifique et à l’universalisation du langage musical. Dans ce contexte, tout comme la ballade littéraire était dans une certaine mesure l’équivalent du théâtre, la ballade de Chopin était l’équivalent de l’opéra. Dans les deux cas, la concision s’accompagne d’expressivité, et la puissance de l’émotion est renforcée par la clarté du message.
Les ballades de Chopin
.Ce n’est sûrement pas un hasard si Chopin – si réticent à révéler quoi que ce soit de la genèse de ses œuvres – au cours d’une visite chez Robert Schumann en 1836, juste avant la publication de la première de ses quatre ballades – Les ballades en sol mineur – a mentionné les ballades de Mickiewicz comme source d’inspiration. Schumann a perpétué un autre détail de cette visite – cette composition lui était particulièrement chère, ainsi qu’à Chopin lui-même, et rappelons que c’est Schumann, du même âge que lui et provenant aussi de Varsovie, qui révéla au monde ce génie, dont il connaissait parfaitement les œuvres, même si au fil du temps, il comprenait de moins en moins son itinéraire à la fois personnel et révolutionnaire en musique. Et pourtant, les ballades suscitaient en lui un grand enthousiasme, et lorsque lui fut dédiée la deuxième ballade, en fa majeur, il nota : « un poète pourrait sans difficulté trouver des paroles pour sa musique ; elle touche au plus profond » [3[.
Non seulement Chopin renonçait au texte – et depuis le Moyen Âge, il était si étroitement intégré au genre de la ballade musicale que les éditeurs en Allemagne et en Angleterre, lorsqu’ils annonçaient de nouvelles compositions, expliquaient qu’il s’agissait de ballades sans paroles – mais comme à son habitude, il ne leur donnait pas non plus de titre programmatique qui puisse suggérer leur lien avec des œuvres littéraires précises. Il semble donc que les inspirations provenant des textes de Mickiewicz mentionnées par Schumann soient de nature générale, et concernent une certaine atmosphère, un type de narration ou l’expressivité de la dramaturgie. Bien que des tentatives aient été faites pour rattacher les diverses ballades de Chopin aux poèmes de Mickiewicz, elles n’ont été reconnues ni par les musicologues, ni par les mélomanes. Seule la structure musicale de la Ballade en fa majeur, avec ses deux thèmes extrêmement différents dès le début, sa disposition insolite des tonalités (le deuxième thème – « sauvage » dans sa dynamique – est en la mineur, ce qui n’est pas conforme aux conventions) et la fin innovante de la pièce, dans la tonalité du deuxième thème (au lieu de la tonalité de base), présente certaines analogies avec la structure de la ballade « Świteź » de Mickiewicz, mais ces analogies semblent être d’une nature si générale qu’il serait difficile de défendre la thèse d’une reproduction volontaire du texte en musique.
La ballade littéraire, grâce à sa régularité rythmique, sa mélodie spécifique et sa structure formelle – par exemple la présence de refrains – est l’un des genres les plus « musicaux », même si elle n’est pas accompagnée de musique au sens strict. Inversement, Chopin incorpore un certain nombre de caractéristiques de la langue dans ses ballades, à la fois dans la manière dont le matériau est façonné, dans ses caractéristiques rythmiques et dans son expressivité émotionnelle. Chacune de ses quatre ballades a une structure et une dramaturgie légèrement différentes, chacune a sa manière de mettre en forme le matériau musical, mais dans chacune d’elles, le plus grand point culminant n’apparaît que dans les dernières mesures. Ce n’est pas un arrangement typique des compositions musicales de l’époque – en règle générale, le point culminant était placé autour du nombre d’or du morceau, et la dernière phase de la composition visait à résoudre les conflits (avec notamment l’accord de la tonalité des thèmes avec la tonalité de base) et à tempérer les émotions. C’est pour cette raison que l’on souligne souvent la caractéristique symétrie en arche des formes musicales classiques. Dans les ballades de Chopin, la tendance à atteindre un point culminant à la toute fin de la pièce – malgré des fluctuations de tension tout au long du morceau – est si caractéristique, que l’expression « ballade » est souvent utilisée pour décrire ce type de composition musicale.
Il est particulièrement important de souligner que dans chacune de ses ballades, les thèmes sont soumis à des variations qui changent leur caractère, ce qui est l’un des moyens les plus puissants de la narration musicale dans les œuvres instrumentales. Les auditeurs ont tendance à personnaliser les pensées musicales, et lorsque le thème change de caractère, il semble soudain doté d’une âme ou même personnifié, et ces changements sont alors perçus comme ceux d’un personnage, dont le morceau semble évoquer l’histoire. L’élaboration des thèmes musicaux a une très longue tradition, mais ils ont été particulièrement explorés à l’époque baroque, à travers ce qu’on appelle les variations ostinato, dans lesquelles une formule constante répétée plusieurs fois dans la voix de basse était accompagnée de variations de plus en plus audacieuses, souvent improvisées, de la mélodie. Cependant, ces variations visaient principalement à montrer les capacités de l’instrument et l’habileté de l’interprète, à explorer les procédés et les effets qui pouvaient être obtenus, et les transformations du caractère du thème étaient plutôt la simple conséquence des changements musicaux choisis. C’est le romantisme qui a commencé à explorer les transformations du caractère des thèmes à des fins expressives, comme moyen de construire un récit musical, et Chopin, dans ses ballades, est devenu l’un des précurseurs de ce courant. Dès la Ballade en sol mineur, le premier thème, calme au début, et presque indifférent, prend peu à peu des traits dramatiques, voire tragiques, et le deuxième thème, très proche d’un cantilène, se change en une sorte d’apothéose. Cette transformation du deuxième thème devient un trait caractéristique des ballades de Chopin, bien que dans la deuxième ballade déjà mentionnée – en fa majeur – le deuxième thème absorbe en quelque sorte le premier, ce qui peut être un parallèle métaphorique à la submersion d’une ville sans défense, qui s’enfonce dans les eaux d’un lac suite à l’invasion barbare des armées russes. Cependant, indépendamment des éventuelles connotations littéraires, de telles transformations incorporées à une forme musicale lui confèrent des caractéristiques narratives, et augmentent la suggestivité d’un discours artistique dénué de parole.
Les ballades de Chopin se distinguent par un autre procédé important, concernant l’agencement du matériau musical et de ses accents. Tout d’abord, le compositeur utilise une mesure composée (6/8 ou 6/4), ce qui rend ses thèmes proches du rythme des chansons. Ce n’est pas un hasard si l’idylle de Karpiński Laura et Filon (« Un mois s’est écoulé, les chiens se sont endormis | Une rumeur d’applaudissements s’élève de la forêt ») est en 6/8, et c’est ainsi que Chopin l’a écrite dans son pot-pourri de jeunesse – Fantaisie sur des airs polonais. Le poème est basé sur ce qu’on appelle « la strophe de Stanisław » (avec un agencement alterné de syllabes 10 + 8), également utilisée par Mickiewicz dans ses ballades, y compris dans l’une des plus célèbres – Świtezianka (« Quel est donc ce garçon si jeune et beau ? | Qui est cette jeune femme à côté ? ») ou la romance Dudarz. Mickiewicz emploie parfois aussi une variante plus longue de cette strophe (11 + 8, par exemple dans les ballades Świteź ou Powrót taty). Ces similitudes indiquent un lien étroit entre la métrique musicale choisie et les textes des ballades littéraires. La mesure permet de regrouper les sons sur plusieurs plans et de les façonner sur le modèle des syllabes, des mots, des vers ou strophes d’un poème, et le nombre d’unités dans une mesure rend possible une telle disposition du texte, qu’à la strophe correspond un moment musical. Le deuxième procédé métrique est l’utilisation de pieds de référence, tels que l’iambe ou la trochée, qui apparaissent dans les thèmes clés de toutes les ballades de Chopin, déterminant souvent leur essence musicale, comme dans le premier thème de la Ballade en fa majeur ou le deuxième thème de la Ballade en la bémol majeur, dans lesquels la mélodie apparaît progressivement, après que des rythmes réguliers sur les mêmes notes se sont fait entendre. On peut comprendre cela comme une sorte d’archaïsation de l’énoncé, bien que dans la couche purement musicale, notamment harmonique, le compositeur ouvre dans ses ballades les chemins de l’avant-garde romantique. Mais surtout, cela rend le rythme de la musique semblable à celui de la parole. Le troisième procédé consiste à former une mélodie qui évoque des questions et des réponses, comme dans le thème principal de la Ballade en sol mineur. Le début identique de nombreuses phrases constitue en outre une sorte d’anaphore, rapprochant encore le flux musical de la structure du poème. Enfin, dans une perspective plus large, Chopin semble brouiller les symétries, maintenir la fluidité de l’énonciation et transformer plastiquement le matériau, afin de donner l’impression d’un récit continu. Et cette juxtaposition – d’une certaine régularité dans les détails, et en même temps d’une continuité ininterrompue au niveau de l’ensemble – semble être sa création structurelle la plus magistrale, dans sa construction d’histoires sans paroles.
Les procédés mentionnés ci-dessus s’accompagnent à chaque fois d’une mise en forme extrêmement plastique des émotions à travers la musique. Toute tentative de décrire les ballades de Chopin sans termes à forte teneur émotionnelle donne l’impression que leur essence a été perdue. Ces émotions, façonnées de manière extrêmement suggestive, s’interpénétrant, se transformant et s’affrontant, conduisant finalement toujours à un conflit et à une éruption finale, sont sûrement la couche la plus fondamentale de la narration des ballades de Chopin, en cela profondément identiques à leur modèle littéraire.
La Ballade en fa mineur
.La quatrième pièce, la Ballade en fa mineur, op. 52, présente toutes les caractéristiques du genre mentionné ci-dessus. Elle fut composée en 1842 à Nohant, au seul endroit qu’il aura pu considérer comme sa véritable maison à l’étranger, créée pour lui par George Sand dans sa propriété de campagne, où, après une crise de santé à Majorque lors de laquelle il avait frôlé la mort, Chopin composa ses plus précieux chefs-d’œuvre. Il s’agit de la dernière ballade, bien que ce genre soit aussi visiblement évoqué par la Barcarolle en fa dièse majeur (1845), qui couronne cette période de son œuvre. La Ballade en fa mineur se distingue par une trace d’archaïsation encore plus profonde que les autres pièces : son thème principal, dans son caractéristique balancement des sphères, pour ainsi dire, présente certains traits des thèmes de Bach, et la polyphonie baroque semble s’harmoniser magistralement avec un travail de variation classique. Cette composition synthétise les tendances dramaturgiques mentionnées précédemment, avec une variation symétrique en forme d’arche, suggérant l’influence de la forme classique de la sonate. Le thème principal est soumis à des variations qui épaississent progressivement le tissu sonore, introduisant l’auditeur dans un monde de plus en plus émouvant et mystérieux. Mais – comme dans les autres ballades – c’est le second thème, ici originellement hymnique, transformé en une sorte d’apothéose, qui est le but de toutes les tensions progressivement accumulées. Cette apothéose ne clôture pourtant pas la pièce, et la musique qui apparaît ensuite est sans précédent, même dans l’œuvre de Chopin. Liée au matériau sonore des thèmes d’une façon seulement allusive, elle constitue l’apogée absolue d’une sorte de déclaration personnelle extrêmement dramatique. Pour citer Mieczysław Tomaszewski : « […] au point culminant du récit de la ballade, il est impossible de trouver les mots justes. Cette explosion de passions et de sentiments, exprimée à travers des passages balancés et des accords saturés de substance harmonique, n’a pas d’égal. […] Nous sommes en présence de l’expression à son plus haut degré de puissance, sans la moindre trace d’emphase ou de pathos »[4].
Le manuscrit de la Ballade en fa mineur présenté dans cette exposition est un document très particulier car il donne un aperçu sur un processus créateur qui, dans la plupart des cas, en raison de la rareté des esquisses conservées, ne peut faire l’objet que de spéculations plus ou moins fiables. Le manuscrit contient la première version de l’ouvrage sous une forme destinée à l’impression mais finalement restée inédite. Il s’agit d’une situation exceptionnelle – le compositeur s’efforçait en général d’utiliser des manuscrits même fortement corrigés, en les envoyant à l’éditeur français, qui lui renvoyait des tirages d’essai pour relecture. Dans le cas de cette Ballade, pourtant, très probablement après l’achèvement de cette pièce, Chopin a décidé de changer la mesure 6/4 en 6/8, ce qui rendait impossible la réutilisation de ce manuscrit, car toutes les valeurs auraient dû être réduites de moitié. Il se remit donc au travail, malgré sa réticence bien connue à copier les notes de musique, et conserva le manuscrit présenté ici dans ses documents, jusqu’à sa mort. La mesure originale peut suggérer une certaine référence à la première pièce, la Ballade en sol mineur, qui est la seule en 6/4, ce que complèteraient des traits musicaux tels que la tonalité mineure (les deuxième et troisième ballades sont en tonalité majeure), ou l’idée d’ajouter une large fin dramatique à la pièce après la transformation finale des thèmes principaux. Cependant, dans la dernière étape de la révision, le compositeur craignait probablement qu’avec un matériau musical ainsi formé, les interprétations deviennent trop statiques. Le changement de métrique d’une noire en une croche ne signifie pas que le morceau doive être joué deux fois plus vite. Le tempo de la musique est influencé – à l’exception des durées rythmiques – par des clarifications verbales ou des indications métronomiques, par ailleurs il existe également des conventions concernant le tempo de la musique elle-même par exemple dans les danses. La Ballade en fa mineur a finalement été annotée du terme « Andante con moto », qui correspond à un tempo modéré (« Andante » est un tempo de marche), mais avec du mouvement, donc Chopin a probablement pensé que l’écrire en croches permettrait de mieux comprendre son intention de maintenir une certaine dynamique. Les trois croches groupées par trois en ligature, c’est ainsi qu’on note la mesure 6/8, font aussi en quelque sorte référence à la convention de notation des mélismes, c’est-à-dire des fragments vocaux dans lesquels plusieurs notes correspondent à une syllabe du texte. Tous ces arguments montrent que Chopin tenait si fortement à ce que le pianiste ne perde pas ce flux narratif, qui est une caractéristique fondamentale de chaque ballade, qu’il a décidé de réécrire la partition.
Après la mort de Chopin, le manuscrit a été offert par sa sœur Ludwika Jędrzejewiczowa à un compositeur tchèque, Joseph Dessauer, qui appartenait au cercle de ses amis parisiens (Chopin lui a dédié les Polonaises op. 26). Une annotation réalisée de la main de Ludwika sur la première page du manuscrit : « p[our] M[.] Des[s]auer. », apparemment encore à Paris, au cours de la mise en vente de l’appartement du numéro 12 de la place Vendôme, le confirme. Il est hautement probable, que le manuscrit était alors complet ou incluait une plus grande partie que le bifolium (4 pages) comprenant 79 mesures de l’œuvre conservée jusqu’à nos jours. En effet, c’est avec certitude, que la version originale ne se terminait pas là où elle s’arrête aujourd’hui, car la musique s’interrompt sans la moindre annonce de la fin de son travail à cet endroit. D’autre part, l’excellent état de conservation montre, qu’il a été conservé par Chopin avec un soin particulier, donc il ne semble pas probable qu’il ait été soumis à une fragmentation avant sa mort. En l’absence d’informations sur le devenir du manuscrit jusqu’en 1933, quand il est apparu à une vente aux enchères à Lucerne, il était déjà sous la forme présentée actuellement. Il a été acheté par un collectionneur autrichien connu, Rudolph Kallir et au cours de la Deuxième Guerre mondiale a été emporté à New York, où il a été conservé par ses héritiers. En décembre 2024, le manuscrit a été acheté par l’Institut National Frédéric Chopin et est un des plus précieux objets de la collection du Musée Frédéric Chopin à Varsovie.
.La Ballade en fa mineur, considérée comme le sommet du genre par ses références à la tradition, sa force créatrice de nouvelles orientations pour les générations suivantes de compositeurs, à travers l’objectivité des procédés alliée à une expression extrêmement personnelle, est la quintessence du syncrétisme, un symbole singulier de la perception romantique du monde, et en même temps un message intemporel, compréhensible et interprété de manière créative jusqu’à nos jours. C’est pourquoi le manuscrit de la Ballade, accompagné ici d’un objet très différent, témoignage du milieu fréquenté par Chopin, de son entourage et de son humour – l’Éventail des caricatures d’Auguste Charpentier et George Sand – constituent l’axe de l’exposition La Vie romantique. Comme deux masques du théâtre antique, ils délimitent l’espace entre le sacré et le profane, l’esprit et la matière, l’art et la vie dont il naît. Dans cet espace sont disposées des traces matérielles du travail créateur d’artistes exceptionnels, formant un cercle particulier, au centre duquel se trouve un espace dématérialisé, rempli de la musique de la Ballade en fa mineur de Frédéric Chopin.
[1] A. Mickiewicz, Préface de Poezye Adama Mickiewicza, Wilno 1822, p. XL.
[2] Chopin a utilisé cette expression dans une lettre à Jan Matuszyński de 26 décembre 1830.
[3] R. Schumann, la revue de Deux Nocturnes, op. 37, de la Ballade en fa majeur, op. 38 et du Waltz en La bémol majeur, op. 42, Neue Zeitschrift für Musik, 15/1841, n° 36 du 2 novembre, p. 141–142.
[4] M. Tomaszewski, Ballade en fa mineur, op. 52, d’un cycle d’émissions Les œuvres complètes
de Frédéric Chopin La Radio Polonaise, 2e Programme – texte remanié accessible sur le site de
l’Institut National Frédéric Chopin : https://chopin.nifc.pl/pl/chopin/kompozycja/115, consulté le
17 février 2025.