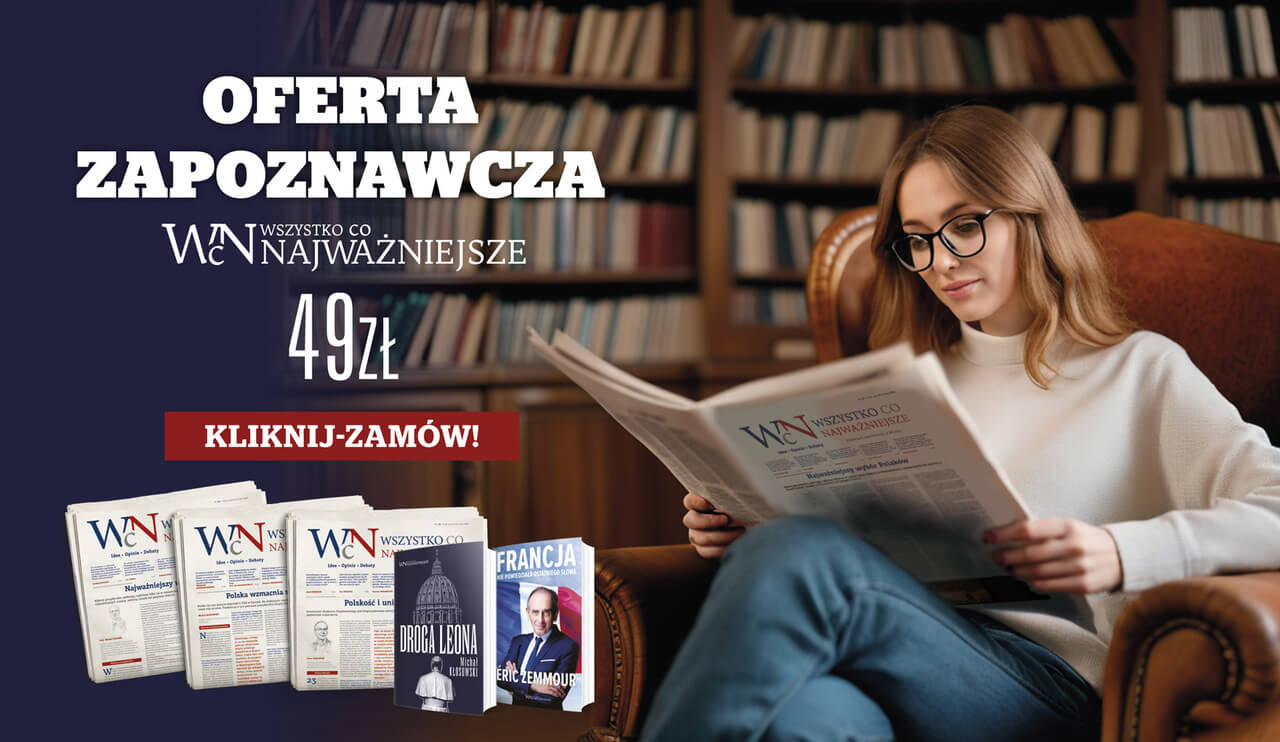Les Trois Glorieuses, deuxième révolution française
Les Trois Glorieuses, deuxième révolution française
Les journées révolutionnaires du 27 au 29 juillet 1830, appelées „Trois Glorieuses”, ont provoqué la chute de la Restauration et l’établissement de la Monarchie de Juillet. Elles eurent des conséquences importantes en Europe, notamment en Pologne.
Un contexte d’instabilité sociale et politique
.A la chute de Napoléon Bonaparte en 1814, les alliés de la Sixième Coalition remirent les Bourbons sur le trône de France, en la personne de Louis XVIII, frère de Louis XVI. La Restauration fut dès le début un régime fragile: quelques mois à peine après le retour de la monarchie, Napoléon quitta son exil sur l’île d’Elbe et reprit le pouvoir. Louis XVIII dut se mettre sous la protection des puissances ennemies, en particulier du Royaume-Uni. La défaite finale de Napoléon, à Waterloo, entraîna une seconde restauration, toujours avec Louis XVIII.
Les premières années suivant ce retour sont difficiles pour la France : le pays est occupé par les vainqueurs (Prusse, Autriche, Russie, Royaume-Uni), les partisans de l’Empire sont réprimés, les récoltes sont mauvaises. La chambre des députés est dissoute en 1816 et à partir de là, la politique des gouvernements suivants oscille entre monarchisme libéral modéré („doctrinaire”) et „ultraroyalisme”. La mort de Louis XVIII en 1824 et sa succession par son frère Charles X renforcent le camp „ultra”.
La politique de Charles X consiste à affaiblir l’héritage de la Révolution et à remettre au premier plan les valeurs et traditions de l’Ancien régime, sans pour autant rompre avec la Constitution de 1814. L’opposition libérale se raidit, les tensions se multiplient tandis qu’une crise économique débute en 1827 et 1828.
En mai 1830, la situation s’envenime. Charles X souhaite provoquer un coup de force afin d’affermir son pouvoir et affaiblir les oppositions. C’est dans ce contexte qu’est décidée entre autres l’expédition d’Alger. Une nouvelle dissolution se transforme en débâcle pour le roi. Le 25 juillet, il dépose les „Ordonnances de Saint-Cloud” qui abolissent la liberté de la presse, renvoient la chambre nouvellement élue et modifient les règles du suffrage censitaire afin d’en écarter la bourgeoisie libérale. Charles X est immédiatement accusé de vouloir mener un coup d’Etat constitutionnel.
Les Trois Glorieuses
.Les protestations contre les ordonnances sont menées dès le 26 juillet par Adolphe Thiers et les libéraux. Des attroupements se forment dans Paris et le Président du Conseil des ministres, Jules de Polignac, est agressé dans la rue par des manifestants. Les journalistes protestent contre la censure et publient des appels allant dans ce sens. Aucun évènement décisif n’a lieu durant cette journée.
Le lendemain, la police descend dans les rédactions accusées de s’opposer aux ordonnances. La colère et la révolte s’étendent à toutes les couches de la population parisienne : bourgeois, commerçants, étudiants, libéraux, républicains, bonapartistes… Le maréchal Marmont est nommé commandant de Paris et reçoit l’ordre de ramener le calme, par la force s’il le faut. Il est à la tête de 12 000 soldats, dont beaucoup sont inexpérimentés.
Des barricades se dressent dans toute la ville, les premiers combats éclatent autour de la place du Palais-Royal. Ce 27 juillet est la premières des journées appelées Trois Glorieuses. L’Angleterre et la Russie commencent à s’inquiéter de la situation à Paris et cherchent à soutenir Charles X. Ce dernier, hanté par le sort de son frère Louix XVI, ne souhaite pas d’intervention étrangère. Des armureries sont pillées, des soldats attaqués. Marmont décide de réagir, il fait occuper par ses troupes les carrefours et les places stratégiques de la ville, fait abattre des barricades et disperser la foule. Au début de la nuit, la stratégie semble avoir fonctionné et Charles X est rassuré. Les soldats se retirent en bon ordre et les renforts ne sont pas appelés.
Le lendemain, la situation dégénère. Les émeutes reprennent, plus nombreuses et plus intenses. La ville se hérisse à nouveaux de barricades et d’obstacles en tout genre. Les soldats sont appelés à changer de camp et à se rallier aux émeutiers. Beaucoup le font, des milliers, semant le trouble au sein de l’armée. Charles X demande à ses hommes de renforcer la défense du Louvre et des Tuileries. Les trois colonnes envoyées par Marmont débloquer les centres névralgiques de Paris doivent se replier, harcelées par la foule et les soldats ayant fraternisé. L’Hôtel de Ville et Notre-Dame tombent aux mains des insurgés, des drapeaux tricolores, symbolisant la république, se mettent à flotter en divers endroits. Marmont s’écrie, à l’adresse du roi : „Sire, ce n’est plus une émeute, c’est une révolution”.
Le 29 juillet, c’est l’effondrement. Les points de défense des armées royales sont assaillis et submergés, des régiments entiers désertent. L’ordre est donné d’évacuer Paris. Les combats ont fait des centaines de morts et des milliers de blessés. Les négociations commencent. Aucune ligne directrice ne ressort de la révolution. Le principe de monarchie ne semble pas menacé, hormis par une minorité de radicaux occupant l’Hôtel de Ville. La foule parisienne s’était surtout soulevée contre les ordonnances liberticides de Charles X et le mouvement n’a pas été suivi dans le pays. Il n’est pas question d’instaurer la République, régime brutal qui a provoqué une grande guerre européenne il y a à peine 40 ans. Cependant, Charles X doit abdiquer.
Le 30 juillet, la chambre décide de confier le royaume à Louis-Philippe, duc d’Orléans et cousin de Charles X. C’est l’avènement de la monarchie dite „de juillet”, du nom de la révolution qui en est à l’origine. Régime plus libéral que le précédent, La monarchie de juillet rompt avec le droit divin et Louis-Philippe sera intronisé roi des Français (et non pas sacré roi de France). Le nouveau roi fait entrer la France dans la révolution industrielle et souhaite gouverner de manière modérée. Il devra néanmoins faire face à de nombreux soulèvements républicains, légitimistes et bonapartistes et une nouvelle révolution, en 1848, mettra fin à son régime.
Victor Hugo commentera ainsi les combats ayant eu lieu durant les Trois Glorieuses :
„Trois jours, trois nuits, dans la fournaise
Tout ce peuple en feu bouillonna,
Crevant l’écharpe béarnaise
Du fer de lance d’Iéna.
En vain dix légions nouvelles
Vinrent s’abattre à grand bruit d’ailes
Dans le formidable foyer ;
Chevaux, fantassins et cohortes
Fondaient comme des branches mortes
Qui se tordent dans le brasier !”
(Victor Hugo, „Les chants du crépuscule”)
La révolution de Juillet marquera l’imaginaire de la gauche, en témoigne le célèbre tableau de Delacroix „La Liberté guidant le peuple”. Le rôle politique de Paris sort grandi, c’est bel et bien ici que se décide le destin de la nation. Par ailleurs, les Trois Glorieuses n’ont pas eu de conséquences qu’en France. Elles ont entraîné des remous dans l’Europe entière.
Des répercussions dans toute l’Europe
.Si dans un premier temps, les puissances européennes sont rassurées que la France n’ait pas sombré dans la violence et la république, elles doivent déchanter après quelques mois. Metternich affirme à l’occasion : „Quand Paris éternue, l’Europe s’enrhume”. Ce sont la Belgique, la Suisse, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et la Pologne qui connaitront des troubles, des rébellions, des insurrections.
Fin aout, les bruxellois se révoltent contre la présence hollandaise. Les Pays-Bas, en réponse, envoient des troupes, ce qui provoque un conflit qui fera des centaines de morts et incitera les Belges à proclamer leur indépendance, avec le soutien du Royaume-Uni. Royaume-Uni qui connaîtra peu après des troubles politiques graves entre whigs (libéraux) et tories (conservateurs). Craignant la propagation de la révolution, les tories céderont le pouvoir aux whigs après une réforme électorale.
En Allemagne, plusieurs Etats subissent des sursauts révolutionnaires : la Hesse, la Saxe, le Hanovre et le Brunswick. Des constitutions d’inspiration libérale y sont proclamées. En Italie, le concept de „Risorgimento” se répand, dans un pays éclaté en plusieurs Etats et royaumes. Les Autrichiens interviennent afin de réprimer un début d’insurrection, avec l’accord d’une France soucieuse de ne pas s’impliquer dans des conflits révolutionnaires en Europe.
C’est en Pologne que la vague des Trois Glorieuses se fera le plus ressentir. Le pays avait été partagé entre la Prusse, la Russie et l’Autriche à la fin du XVIIIème siècle. Napoléon Bonaparte avait rétabli un Duché de Varsovie en 1807, qui ne survivra pas à la chute de l’Empire. Le tsar Napoléon I permit à la Pologne de conserver un semblant d’autonomie et les institutions du Duché de Varsovie. Tout au long des années 1820, cependant, les libertés octroyées par les Russes seront de plus en plus réduites. Craignant que le tsar ne mobilise des Polonais pour réprimer les soulèvements en France ou en Belgique, des groupes indépendantistes passent à l’action lors de la célèbre journée du 29 novembre 1830. Face à cela, le tsar refuse de tergiverser, ce qui avait couté sa position à Charles X et la Belgique à Guillaume I. Le 25 janvier 1831, le parlement polonais déclare l’indépendance de la Pologne et la Russie réagit en envahissant le pays. Après quelques batailles indécises, les armées russes finissent par écraser les insurgés. La Russie dissoudra la Chambre et s’attaquera à la culture polonaise. Des milliers de nobles, de politiques, d’intellectuels seront contraints d’émigrer, pour beaucoup en France, dont l’opinion publique avait beaucoup soutenu l’”insurrection de novembre”.
Le vent de liberté initié par la révolution de juillet et les Trois Glorieuses a donc certes touché une partie importante de l’Europe, mais sans provoquer de bouleversements décisifs, en dehors de l’indépendance belge.
Jacques Bainville, dans son „Histoire de France”, décrira avec une touche d’ironie les événements de Paris : „Ainsi, républicains et bonapartistes avaient fait la Révolution, et le parti constitutionnel l’avait confisquée. Les insurgés subissaient une autre monarchie. Mais, comme le disait l’un d’eux, ce que les vainqueures des « Trois Glorieuses » avaient espéré, République ou Empire, ce serait « pour plus tard ».
Nathaniel Garstecka